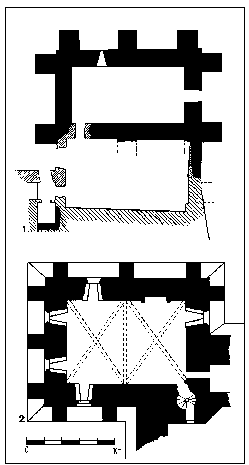|
Mémoires |
BULLETIN DE L'ANNÉE ACADÉMIQUE
1995-1996
établi par Maurice SCELLÈS
Cette édition électronique respecte la mise en page de l'édition imprimée (Bulletin de l'année académique 1995-1996, dans Mémoires de la Société Archéologique du Midi de la France, t. LVI, 1996) dont nous indiquons la pagination. Les corrections nécessaires ont été apportées et quelques illustrations en noir et blanc sont remplacées par des illustrations en couleur.
| 1ère partie Séances du 7 novembre 1995 au 9 janvier 1996 |
2e partie Séances du 23 janvier 1996 au 30 mars 1996 |
M.S.A.M.F., T. LVI, page 281
SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 1995
Présents : MM. Pradalier, Président, Coppolani, Directeur, Ahlsell de Toulza,
Trésorier, Latour, Bibliothécaire-archiviste, Cazes, Secrétaire Général, Scellès,
Secrétaire-adjoint ; Mmes Blanc-Rouquette, Cazes, Noé-Dufour, Labrousse,
Watin-Grandchamp, MM. l’abbé Baccrabère, Catalo, le général Delpoux, Ginesty,
Gillis, Hermet, Julien, Lassure, Mange, le Père Montagnes, Peyrusse, Tollon.
Excusé : M. Péaud-Lenoël.
Invitée : Mlle Yulia Kalchenko.
Le Président proclame l’ouverture de l’année académique en souhaitant que notre Société poursuive le très bon travail dont témoigne la publication désormais reconnue que sont nos Mémoires.
Puis il rappelle que nous avons eu la douleur de perdre notre confrère Richard Boudet dont chacun avait pu apprécier la compétence au cours des informations qu’il ne manquait pas de donner à notre Société sur ses travaux ou encore par les discussions qu’il savait susciter. Richard Boudet est mort brutalement après une pénible marche jusqu’à la grotte-sanctuaire de l’Ourtiguet sur le Larzac : il avait 38 ans.
Se tournant vers notre invitée, le Président souhaite la bienvenue à Mlle Yulia Kalchenko, employée de la ville de Kharkhov en Ukraine et actuellement à Toulouse pour deux mois de stage à la D.R.A.C. et au théâtre du Capitole, qui a souhaité assister à nos séances et que nous accueillons bien volontiers.
Le Président donne ensuite la parole au Secrétaire-adjoint pour la
lecture du procès-verbal de la séance du 20 juin 1995, qui est adopté.
À propos de la statue de « Dame Toulouse »,
Annie Noé-Dufour fait remarquer qu’elle figure sur la liste des objets protégés au
titre des Monuments historiques. Bruno Tollon confirme qu’elle a été classée le 10
mars 1942, au titre objet ; Louis Peyrusse note que cette mesure de protection a sans
doute été prise en urgence pour éviter qu’elle ne soit envoyée à la fonte en
application de la loi sur la récupération des métaux non-ferreux. Le Président
précise qu’il a adressé à ce sujet un courrier au Maire de Toulouse, en demandant
que la statue soit mise à l’abri.
Puis le Président rend compte de la dernière réunion du Bureau.
Notre Société va récupérer les statues-menhirs qui sont actuellement en dépôt au
Musée Saint-Raymond. Celles-ci seront présentées dans nos nouveaux locaux.
Louis Latour et Mlle Haralsdottir vont entreprendre la saisie des
procès-verbaux de premières séances de la Société en vue de leur publication.
Enfin, le Bureau doit se rendre à Martres-Tolosane pour prendre
contact avec notre fermier et lui demander d’éviter les labours profonds sur les
parcelles du site de la villa romaine de Chiragan, dont les terres pourraient être mises
en prairie.
Le Président donne alors la parole à M. l’abbé Baccrabère pour une communication sur les Fours de potiers à Saint-Michel du Touch, au Ier siècle avant J.-C., publiée dans ce volume (t. LVI, 1996) de nos Mémoires.
Le Président remercie l’abbé Baccrabère pour cette nouvelle
communication où il a su rester fidèle à ses principes, décrivant précisément les
découvertes qu’il a pu faire tout en se gardant d’interprétations hâtives.
Louis Latour remarque que les tessons présentés appartiennent à la
poterie commune de la région. Jean-Luc Boudartchouk
M.S.A.M.F., T. LVI, page 282
demande, après avoir relevé que le mobilier retrouvé peut être daté au plus tard
du tout début de notre ère, si l’on a une idée du moment où ces fours ont été
abandonnés. L’abbé Baccrabère précise que la campanienne la plus récente peut
aller jusqu’aux années 50 ou 40 avant J.-C. et l’arétine en effet aux
alentours du début de notre ère, ce qui situerait le moment de leur abandon. Jean-Luc
Boudartchouk a également noté un four avec des tegulae et des imbrices, ce
que confirme l’abbé Baccrabère en rappelant que des tegulae sont connues sur
le site de Vieille-Toulouse pour une époque ancienne. M. Manière note que ces fours sont
tout à fait comparables à ceux qu’il a pu fouiller à Saint-Cizy, et il pourrait,
si la Compagnie le souhaitait, en présenter des diapositives lors d’une prochaine
séance ; dans l’un de ces fours a été retrouvé le passage qui permettait à un
enfant d’en effectuer le chargement.
Répondant à une question de Louis Peyrusse, l’abbé Baccrabère
précise que l’on avait effectivement à cet endroit un quartier de potiers.
Quitterie Cazes demande si des dépotoirs ont été repérés. L’abbé Baccrabère
pense que les tessons qu’il a retrouvés appartiennent aux productions de ces fours.
Jean-Luc Boudartchouk se dit intéressé par le four médiéval qui a
été mentionné. L’abbé Baccrabère, après avoir indiqué que celui-ci fera
l’objet d’une prochaine publication dans les Mémoires de l’Académie
des Sciences, précise qu’il était assez semblable au four à chaux qui vient
d’être mis au jour par les fouilles du Musée Saint-Raymond ; ce four avait
d’ailleurs servi à fabriquer de la chaux, et on y a retrouvé des fragments de
sculpture avec en particulier un chapiteau.
Henri Ginesty demande ce que sont devenus ces fours. L’abbé
Baccrabère répond qu’ils ont disparu au cours des travaux, mais que d’autres,
dont il a pu repérer précisément les emplacements, subsistent sans doute sur ce terrain
qui a toutefois été très bouleversé.
Le Président indique que nous avons reçu de la part des étudiantes du « D.E.S.S. patrimoine » et du responsable de cette formation, notre confrère Louis Peyrusse, le catalogue de l’exposition « Quercy romantique » qu’ils ont organisée à Cahors. Maurice Scellès ajoute que Valérie Rousset a offert à notre Société le catalogue de l’exposition « Divona : la fontaine des Chartreux » qui a été présentée au cours de l’été au Grenier du chapitre à Cahors.
On procède ensuite à l’élection de membres correspondants. Les rapporteurs ayant été entendus, M. Robert Manuel, M. Yves Cranga et Mme Chantal Fraïsse sont élus membres correspondants.
Le Président présente alors une note d’information sur une stèle discoïdale de Cordes, que nous a adressée M. Robert Manuel qui remplit ainsi pleinement son rôle de membre correspondant de notre Société.
Guy Ahlsell de Toulza présente différentes œuvres d’une
collection particulière qui méritent
d’être signalées et pour lesquelles il se propose de faire des recherches
complémentaires après avoir recueilli l’avis des membres de notre Société.
Un buste d’homme en marbre, dans un parfait état de conservation,
aurait été trouvé en 1914 à Timgad : Louis Peyrusse s’interroge sur le nombre
d’ateliers fabriquant des faux qui pouvaient alors exister à Timgad ; Daniel Cazes
dit qu’il faudrait pouvoir examiner l’œuvre qui est peut-être un peu trop
bien conservée, et il remarque que si la coiffure correspondrait à une représentation
de l’époque de Néron, les yeux pupillés sont en principe caractéristiques
d’œuvres plus tardives.
Une petite fiole en plomb moulé, à décor figuré, proviendrait
d’une collection de Cahors où elle aurait été trouvée au cours d’une
fouille. On peut faire l’hypothèse d’un objet d’importation placé dans
une sépulture.
Deux chapiteaux datables des environs de 1200, hauts de 23 cm environ,
auraient été récupérés, il y a quelques années, dans un fossé voisin de la maison
d’un architecte qui venait de déménager. On peut supposer qu’ils provenaient
d’un chantier traité par cet architecte. Ils offrent l’intérêt
supplémentaire d’être tout à fait semblables à deux chapiteaux d’origine
inconnue du Musée des Augustins (nos 260-261 du catalogue de Paul Mesplé).
Un très beau tableau sur bois de 2 m sur 2 environ, représente La
mort d’Adonis pleuré par Vénus. Il a été publié par Paul Mesplé comme une
œuvre d’Antoine Verrius, alors que Turquin y verrait plutôt un œuvre de la
seconde moitié du XVIe siècle
attribuable à Franz Floris. Pour Bruno Tollon, il serait en effet étonnant qu’une
peinture sur bois ait été réalisée par Antonio Verrio et Louis Peyrusse incline à y
voir un travail anversois.
Le Président remercie Guy Ahlsell de Toulza pour toutes ces informations.
SÉANCE DU 21 NOVEMBRE 1995
Présents : MM. Pradalier, Président, Coppolani, Directeur, Ahlsell de Toulza,
Trésorier, Latour, Bibliothécaire-archiviste, Cazes, Secrétaire Général, Scellès,
Secrétaire-adjoint ; Mmes Cazes, Merlet-Bagnéris, Pradalier-Schlumberger,
Watin-Grandchamp, MM. Bertrand, Cranga, le général Delpoux, Julien, Mange, Nayrolles, le
Père Montagnes, Péaud-Lenoël, Peyrusse, l’abbé Rocacher, Séraphin, Tollon.
Excusés : Mme Heng, M. Gérard.
Le Président ouvre la séance en annonçant trois nouvelles
candidatures au titre de membre correspondant de notre Société.
Puis il donne lecture d’un courrier de M. Michel
Vidal, conservateur régional de l’archéologie, qui informe la Société de sa
M.S.A.M.F., T. LVI, page 283
volonté de proposer à la COREPHAE du 12 décembre prochain la protection au titre des
Monuments historiques de l’ensemble du site de la villa gallo-romaine de
Chiragan. Une telle mesure paraît nécessaire alors que se multiplient les opérations
d’urbanisation en milieu rural. Le Président ajoute que notre Société ne peut
qu’être favorable à une telle mesure, qui survient à point nommé puisque nous
nous inquiétions depuis plusieurs mois du devenir des parcelles que la Société possède
à Martres-Tolosane. Le courrier de M. Michel Vidal ne précise pas la nature de la
protection envisagée, mais on s’accorde pour que la Société Archéologique demande
le classement de l’ensemble des parcelles.
Puis on entend le rapport sur la candidature de Mme Bernadette Suau qui
est élue membre correspondant.
La parole est ensuite à MM. Louis Peyrusse et Jean Nayrolles pour la communication du jour : Les terres cuites de Virebent : première approche.
Le Président remercie Louis Peyrusse de cette communication, et
demande à Jean Nayrolles s’il souhaite y ajouter quelque chose. Celui-ci confirme
son parfait accord avec les hypothèses présentées, en insistant sur le fait que les
productions des Virebent sont très souvent des pièces uniques et non, comme on
l’attendrait devant des chapiteaux par exemple, des productions en série.
Dominique Watin-Grandchamp croit pouvoir distinguer les productions
exceptionnelles destinées à quelques grands chantiers et une production de catalogue ;
elle souligne par ailleurs tout l’intérêt que pourraient avoir aujourd’hui
certains de ces moulages si les originaux ont disparu.
Louis Peyrusse dit que l’on est certain des productions en série
des Virebent, mais que ce qui a fait la renommée de la manufacture, ce sont au contraire
des œuvres qu’il faut retirer aux arts industriels. De ce point de vue, les
fabrications des Virebent sont très différentes des productions saint-sulpiciennes dont
les catalogues montrent des produits peu différenciés proposés dans des matériaux
divers. Bruno Tollon renchérit en faisant remarquer que les propriétaires des châteaux
qui ont fait appel aux Virebent auraient sans doute mal compris que l’on use chez eux
de pièces produites en un très grand nombre d’exemplaires.
Daniel Cazes se souvient qu’il a eu souvent l’occasion, alors
qu’il était au Musée des Augustins, de s’interroger sur le mode de fabrication
de certaines œuvres : on avait l’impression d’être tantôt devant le
moulage exact d’un original, tantôt devant un moulage retouché avec une partie
modifiée ou une lacune comblée, ou encore d’être en présence du moulage
d’une œuvre réalisée à cette seule fin.
Claude Péaud-Lenoël rappelle qu’au moins depuis le début du
XVIIIe siècle, les fabrications
semi-industrielles d’objet en terre cuite nécessitent de réaliser une matrice à
partir de laquelle sont tirés des moules en plâtre dont la durée d’utilisation est
très brève et qui doivent donc être renouvelés. Il voudrait savoir si l’on
connaît certaines matrices des Virebent. Il demande encore si l’on connaît
d’éventuels modèles en bois, et par ailleurs ce que l’on sait des procédés
d’émaillage utilisés par les Virebent. Louis Peyrusse répond qu’il est
certain que toutes les matrices ont disparu, et qu’il ne nous reste que quelques
moules récupérés par la fabrique Giscard dont les pièces ont été inventoriées
récemment par Philippe Gisclard ; il ne croit pas que les modèles aient été en bois,
et imagine plutôt des œuvres modelées en plâtre. Quant aux procédés
d’émaillage, tout ce que l’on sait pour l’instant, c’est que Gaston
Virebent avait reçu une très bonne formation dans ce domaine.
Louis Latour voudrait savoir dans quel cadre s’exerçait la
collaboration entre le sculpteur Salamon, qui devait avoir son propre atelier, et la
manufacture des Virebent. Louis Peyrusse précise que Salamon a en effet exposé seul,
mais qu’il devait être lié par contrat pour certaines réalisations. Guy Ahlsell de
Toulza indique qu’il possède les factures de la manufacture Virebent pour un grand
groupe de l’Assomption exécuté dans le style du XVIIIe siècle pour Rabastens, et qu’il y est fait mention d’un travail de
sculpture dû à Salamon. Daniel Cazes rappelle que le sculpteur Beurné a également
travaillé pour les Virebent, ce que confirme Louis Peyrusse qui indique que l’on ne
sait cependant presque rien de ce sculpteur.
Christian Mange revient sur la question des productions en série et
s’interroge sur la qualité des formes produites par la fabrique Virebent, où il ne
distingue pas de véritable originalité. Louis Peyrusse pense que notre confrère est
bien sévère, et il rappelle qu’il y a eu des productions bien plus médiocres que
celles des Virebent, alors que Jean Nayrolles insiste sur le fait que la fabrique
toulousaine offre un catalogue exceptionnel.
La séance s’achève avec trois brèves communications. Pascal-François Bertrand saisit l’occasion d’une exposition pour compléter l’analyse d’un dessin d’Hilaire Pader :
« Dans la brillante synthèse d’Alain Mérot sur la peinture française au XVIIe siècle (Gallimard/Électa, 1994) figure dignement la production toulousaine et du Midi de la France, ainsi que ses principaux représentants, qu’il s’agisse de Jacques Boulbène, de Jean Chalette, de Nicolas Tournier, du frère Ambroise Frédeau, d’Hilaire Pader, de Jean-Pierre et Antoine Rivalz. La manière « classique » de Tournier (Monbéliard, 1590 - Toulouse, 1639 ?), qui doit à Caravage, outre l’utilisation d’un puissant contraste entre les zones d’ombre et de lumière, un naturalisme exacerbé et à Annibal Carrache une rigueur dans la composition unifiée, est de nouveau rappelée par Véronique Gérard Powell, auteur du chapitre sur le XVIIe siècle du manuel, réalisé sous la direction d’Alain Mérot, Histoire de l’art. 1000-2000, qui vient de paraître chez Hazan (1995), et dans lequel le président de notre Société a écrit la partie consacrée à l’art roman.
Un catalogue d’exposition de Dessins français du XVIIe siècle (Paris, musée du Louvre, 28 janvier - 26 avril 1993) avait également retenu notre attention et nous aimerions revenir sur une des feuilles présentées à cette manifestation. Un dessin du musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon, intitulé Académie d’homme (cat. n° 106), est rendu par Jean-Claude Boyer
M.S.A.M.F., T. LVI, page 284
HILAIRE PADER, ACADÉMIE D'HOMME
OU LE RETOUR D'ÉGYPTE.
Pierre noire, sanguine, crayon brun sur papier beige.
Besançon, Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie.
M.S.A.M.F., T. LVI, page 285
au peintre et théoricien toulousain Hilaire Pader. L’historien s’arrête sur la puissante académie d’homme au premier plan, mais semble éviter d’aborder la petite scène d’un retour d’Égypte figurée à droite légèrement en retrait, bien qu’il rappelle que le peintre célèbre longuement dans sa Peinture parlante parue à Toulouse en 1653 un tableau de Poussin sur ce thème. Dans son dernier ouvrage sur le grand peintre du XVIIe siècle, Jacques Thuillier (Nicolas Poussin, Paris, Flammarion, 1994) cite le passage du livre de Pader, qu’il convient de donner à nouveau :
" I’ai veu chez un Prélat qui chérit son Pinceau
Une vierge & son Fils sur le bord d’un ruisseau,
Qui paroit à nos yeux arrouser son ouvrage :
Un batelier conduit sa nacelle au rivage,
Où la Mère pucelle, avec son chaste Espoux,
Contemplent en IESUS ce qu’il a de plus doux ;
Car bien que tout le soit, la douceur de sa face
Des traicts plus adoucis toute douceur esface :
Sa belle bouche semble estre preste à parler
Pour chérir une Croix qu’il apperçoit par l’air,
Que des enfants aislés de l’empirée apportent,
Et de leurs tendres bras en voltigeant supportent,
Nos yeux verroient ses yeux tourner de toutes parts
Si ce mystique obiect n’arrestoit ses regards ;
Il élève les mains & monstre par son geste
Que son cour reconnoist la machine céleste.
La face de la Vierge invite le Chrestien
D’adlmirer de son Corps le pudique maintien ;
Puisque ce rare ouvrier l’a mise avec aisance,
Sans que rien soit forcé, dedans la bien-séance ;
Le manteau qu’elle porte a droit de nous charmer ;
Non parce qu’il paroist coloré d’Outremer,
Mais d’autant que les plis sont faits avec adresse,
Et font voir tout à coup la force & la tendresse.
Certes, c’est un chef-d’ouvre, & ce chef-d’ouvre est tel
Qu’il mérite à bon droit qu’on l’ait mis sur l’Autel ;
Il n’est point de Tableau, qui d’abord ne luy cède,
Et les beautés de cent luy tout seul les possède "
Cette description a parfois été rapprochée d’un tableau de Poussin du Dulwick College de Londres (vers 1629-1630 ; Thuillier, cat. n° 77), mais elle correspond plus précisément à une autre version peinte par Poussin sur ce thème, conservée au Cleveland Museum of Art (vers 1633 ; Thuillier, cat. n° 89). Si la composition du dessin de Pader est très éloignée de celle du tableau de Cleveland, elle ne peut être réduite à une académie, aussi puissante fut-elle. On sait par ailleurs, ainsi que Jacques Thuillier l’a souligné, que les descriptions des tableaux de Poussin données par Pader dans ses traités sont généralement vagues et confuses, hormis peut-être pour celle du Retour d’Égypte. Ne peut-on pas voir dans le dessin de Besançon sinon une variation, du moins une évocation plus ou moins lointaine d’un original perdu de Poussin que Pader aurait pu admirer sur l’autel de l’oratoire d’un ecclésiastique (toulousain ?), amateur de peinture ? »
Gilles Séraphin expose quelques réflexions sur le donjon médiéval du château de Lavardens en Gascogne :
« Au cœur de l’ancien Fezensac, le bourg castral de
Lavardens est très classiquement établi sur une serre dont l’extrémité rocheuse
servait dès le Moyen Âge de socle à la résidence ou « salle » seigneuriale. Un mur
de ville étoffé de cinq tours quadrangulaires enfermait l’ensemble de ce castelnau
caractéristique, dans lequel avait pris place une imposante église paroissiale.
L’actuel château de Lavardens est attribué pour l’essentiel
à la reconstruction réalisée pour le maréchal de Roquelaure par l’architecte
Levesville à partir de 1608. Cette construction nouvelle succédait à un édifice plus
ancien, attesté dès les années 1140 et dont on sait qu’une part importante des
maçonneries et du rocher qui les supportait fut réutilisée. Manifestement,
l’ancienne forteresse ne fut donc pas rasée dans les années 1575 comme le supposait
H. Polge (Lavardens dans C.A. Gascogne, 1970, p. 225-227).
L’irrégularité totale de l’édifice, aux antipodes d’un autre projet
réalisé pour le même maréchal de Roquelaure au Rieutord, laisse au contraire entrevoir
chez l’architecte de Lavardens un souci réel de coller au plus près aux structures
du château médiéval. La valeur symbolique de l’ancienne citadelle des comtes
d’Armagnac méritait bien, sans doute, quelques égards.
De fait, les différences de maçonneries et d’appareillage font nettement ressortir, au sein de l’édifice du XVIIe siècle, la présence d’un édifice médiéval complexe (J.-H. Ducos, Le château de Lavardens, Flaran, 1986, 40 p.), dont les volumes furent habilement réutilisés. Exemple : les contreforts du massif occidental, devenus les supports d’une galerie sur arcades reliant des tourelles aux encorbellements savants. Exemple encore : l’oratoire seigneurial qui paraît bien s’être installé dans les murs d’une chapelle castrale antérieure.
M.S.A.M.F., T. LVI, page 286
 LAVARDENS, MASSIF OCCIDENTAL DU CHÂTEAU COMTAL. |
 LAVARDENS, BASE DU MASSIF OCCIDENTAL. Les parements en
appareil moyen et les vestiges d'une porte en arc brisé |
Or c’est précisément dans les bases du massif occidental, encadré par des deux tourelles-pavillons, que fut identifié le noyau du château primitif. L’assise de cet ouvrage, de 17 à 18 m de côté, aux murs épais d’1,85 m, épaulés par sept contreforts, laisse entrevoir en effet une hauteur originelle et des proportions considérables. Sans la présence d’une porte en arc brisé ouvrant au rez-de-chaussée, la silhouette caractéristique des donjons romans à contreforts de l’Ouest de la France viendrait d’emblée à l’esprit. Si l’on se réfère à la typologie établie par A. Châtelain, les contreforts de Lavardens, épaulant les maçonneries en laissant dégagé l’angle de la construction, se rattacheraient au « type B » et évoqueraient ceux des donjons de Caen ou de Grez-sur-le-Loing (Donjons romans des pays de l’Ouest, Picard, 1973, p. 27 et s.).
En fait, c’est une tout autre filiation que suggère l’examen du plan de l’ouvrage. Par ses dimensions et son plan de masse comme par certains détails, tels que l’épaisseur des maçonneries, la saillie et la disposition des contreforts, la base du donjon de Lavardens renvoie en effet à des ouvrages nettement plus modernes.
La tour Saint-Laurent du palais des Papes offre ici le premier terme de comparaison. Les dimensions au sol, 17,20 m x 12,50 m, sont du même ordre comme la saillie et le nombre des contreforts. Mais, ici, l’édifice nous est parvenu dans toute son élévation, avec ses 44 m de hauteur. On croit savoir par ailleurs que cette tour, qui fait partie de la campagne de travaux commanditée par Innocent IV, fut élevée entre 1353 et 1358 sous la direction d’un maître d’œuvre originaire d’Ile de France, Jean de Louvres (de Luperiis) (S. Gagnière, Le palais des papes d’Avignon, C.N.M.H., 1977).
Le second terme de comparaison est fourni par un autre édifice prestigieux de la seconde moitié du XIVe siècle, le château royal de Vincennes. Ici, il ne s’agit pas du donjon, édifié pour l’essentiel par Charles V entre 1361 et 1369, mais des tours de la grande enceinte, réalisées après 1364 et vers 1370. On considère généralement que ces tours étaient destinées au logement des princes et des barons de l’entourage royal. On y retrouve encore le principe d’un ouvrage à contreforts saillants, disposés par deux ou trois, pour des tours dont l’élévation dépassait quarante mètres. Mais ici les ressemblances sont plus précises : comme à Lavardens, les contreforts de Vincennes dégagent l’angle de la construction et sont de section carrée (E. Viollet-Le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture, t. IX, p. 107 ; F. Énaud, Le château de Vincennes, C.N.M.H., 1964). On pourrait encore évoquer la tour de Saint-Sauveur-le-Vicomte, donjon d’allure romane, à contreforts dégageant les angles, édifié dans la seconde moitié du XIVe siècle. Elle-même serait une réplique provinciale des tours de l’enceinte de Vincennes (J. Mesqui, Châteaux et enceintes de la France médiévale, Picard, 1991, t. 1, p. 200).
Les vestiges du donjon médiéval de Lavardens sont aujourd’hui insuffisants pour en restituer les dispositions originelles. En revanche, le rapprochement avec les tours d’Avignon et de Vincennes permet d’esquisser des hypothèses. Le programme contenu dans ces tours est variable. Un passage occupait initialement le rez-de-chaussée de la tour Saint-Laurent et deux des tours de Vincennes tenaient, entre autres, le rôle de tours-portes. Mais dans les deux cas, comme sans doute à Lavardens, la fonction résidentielle de ces ouvrages s’impose. À Vincennes, les quatre tours d’angle, loin d’être
M.S.A.M.F., T. LVI, page 287
Reste l’évaluation chronologique. Le seul indice direct, l’arcature en arc brisé de la porte du rez-de-chaussée ne permet pas de trancher. Cependant, si l’on considère que l’édification du donjon de Lavardens pourrait être contemporaine de celle de la tour Saint-Laurent d’Avignon, de l’enceinte de Vincennes ou encore du donjon de Bassoues, il convient alors de l’attribuer à Jean Ier, avant 1373, date de sa mort à Beaumont-de-Lomagne, ou à Jean II, avant 1385, date de sa mort en Avignon. On sait en effet que Lavardens qui était dans le douaire de Régine de Goth depuis 1302, ne fut récupéré par les Armagnac qu’avec Jean Ier à partir de 1327. Ce dernier, rallié à la cause de Charles V à partir des années 1360, occupa manifestement Lavardens dans les dernières années de sa vie. En 1359 (ou 1364 ?), il y rédigea un testament par lequel il instituait une collégiale et en 1372, il y conclut un traité d’alliance avec le sire d’Albret. Surtout, les archives du comte y avaient été transférées en 1373, indice qu’une tour féodale que l’on suppose fraîchement bâtie était susceptible désormais de les accueillir. »
Quitterie Cazes présente les principaux résultats des fouilles de la rue Mage à Toulouse :
« Vestiges d’habitats des Ier et IIe siècles, rue Mage à Toulouse, par J.-Ch. Arramond, S. Bach, Q. Cazes, N. Poux.
La fouille du terrain situé aux nos 24-26 de la rue Mage, inclus dans le périmètre de la ville antique, a permis la découverte de vestiges de deux habitats antiques successifs (1).
Le site présente une occupation humaine dès le Ier siècle de notre ère. Son évolution jusqu’à nos jours est principalement marquée par la présence d’ateliers de tanneurs vraisemblablement dès le XIIIe siècle jusqu’au XVIe siècle (2), puis, au XVIIe siècle,
M.S.A.M.F., T. LVI, page 288
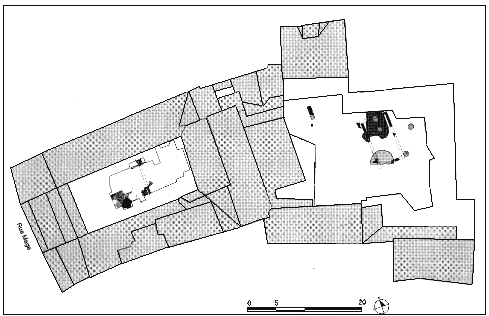
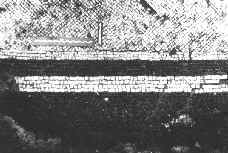 TOULOUSE,
RUE MAGE. |
par la construction d’un hôtel particulier précédant celle des
bâtiments actuels. Seuls les témoins de la période antique feront ici l’objet
d’une analyse. La plus ancienne occupation du site se traduit, dans le jardin, par la présence d’un bâtiment dont seules les fondations ont été conservées. Celles-ci étaient composées de galets disposés dans une tranchée, d’assez petites dimensions (5 à 10 cm de long), les plus importants étant réservés pour le parement. Trois à quatre assises de galets étaient ainsi observables. Le bâtiment lui-même, inégalement conservé, s’étendait sur une surface de 9 m sur 5,20 m (hors-œuvre). Il devait se poursuivre vers l’ouest, comme en témoigne un départ de mur dans cette direction sur le côté nord. |
Aucun niveau de sol contemporain de cette construction n’a
été observé. Le seul élément qui puisse être mis en relation est un caniveau
repéré 9 m plus à l’ouest : constitué de deux assises de briques reposant sur une
rangée de tegulae et couvert de deux nouvelles assises de briques, il possède la
même orientation que le bâtiment.
L’extrême rareté du matériel permet néanmoins de proposer une
datation dans la première moitié du Ier siècle. Le problème de la fonction de ces structures reste posé. À
l’époque antique, elles se trouvaient, comme aujourd’hui, en cœur
d’îlot. En l’absence d’aménagements spécifiques, on pourra donc penser
à un bâtiment secondaire à vocation plus ou moins artisanale ou agricole.
Un autre bâtiment lui succède, sans doute assez rapidement. Si aucun
vestige de mur n’a été conservé, en deux endroits, des fragments d’opus
signinum ont été découverts à 142 m d’altitude. Distants d’un peu plus
de 9 m, ils sont de composition identique
M.S.A.M.F., T. LVI, page 289
et font probablement partie du même ensemble, qui vient occulter au nord la fondation du bâtiment précédemment décrit. Il s’agit d’un pavement imperméable réalisé en béton de tuileau (mélange de chaux, de fragments de tuiles et d’amphores concassées méthodiquement) d’une épaisseur de 0,05 m reposant sur un radier de galets liés au mortier d’une puissance d’environ 0,10 m. Ce dernier est situé directement sur la marne. Le plus grand fragment de mosaïque conservé et déposé mesure 0,80 par 0,48 m. Il est ponctué de plaquettes triangulaires de marbre rose, de tesselles noires rectangulaires et de tesselles blanches carrées (3). La plupart de ces tesselles s’organisent en motifs floraux stylisés, quatre tesselles noires rayonnant vers une tesselle blanche. Certaines de ces dernières ont également été incrustées isolément. La petite taille des fragments de mosaïque parvenus jusqu’à nous ne permet pas de restituer l’organisation stylistique et spatiale d’éventuelles divisions internes. D’autres exemples de ce type de mosaïque sont connus (4), mais sur aucun de ces sites une dévolution ou une localisation spécifique des vestiges étudiés dans un quelconque bâtiment n’a pu être mise en évidence. Ils sont généralement datés des
Ier et IIe siècles après le début de notre ère ; le contexte archéologique de la mosaïque du jardin de la rue Mage situe celle-ci dans la seconde moitié du Ier siècle. Le bâtiment dont ces fragments de mosaïque constituaient le sol avait, nous l’avons dit, entièrement disparu. Il est cependant probable qu’il s’agisse d’une des composantes situées au centre de la parcelle d’une construction à usage d’habitation. Dans la cour, à 142 m d’altitude également, 4 fragments de
mosaïque en opus tessellatum ont été découverts. Ces fragments de facture
homogène ont été réalisés à l’aide de tesselles noires et blanches encastrées
dans un nucleus de mortier rose selon deux plans, l’un oblique, l’autre
orthogonal. Le tout reposait sur un béton de tuileau de deux centimètres environ puis
sur un radier d’une dizaine de centimètres.
Le fragment situé au nord-ouest mesure 15 cm sur 25. Il est composé
de tesselles blanches de petite taille disposées en biais. Au centre, un autre morceau de
25 cm par 10 est fait de tesselles noires rangées en biais. Le troisième vestige de
même type à l’est mesure 20 cm par 30 : des tesselles noires et blanches y ont
été incrustées selon les deux axes. La partie la plus occidentale a été réalisée
avec des tesselles noires disposées à 45° par rapport à la bande noire (de 3 rangées
de tesselles) et à la bande blanche toutes deux de direction nord-sud. Le fragment le
plus grand (45 cm par 25) est situé au sud. Il allie du nord au sud des petites tesselles
blanches suivant un plan oblique, une bande de 3 rangées de tesselles blanches, une bande
de 5 rangées de tesselles noires, une bande de 4 rangées de tesselles blanches, une
bande de 3 rangées de tesselles noires, le tout limité par des tesselles noires
agencées en biais.
Les différences d’orientation et de taille des tesselles
participent au décor ; elles constituent aussi des indices architecturaux. Ainsi
connaît-on plusieurs exemples de mosaïques composées de tesselles noires et blanches
dont les bandes parallèles dessinent un cadre (5). Ces cadres suivis parfois de tesselles
rangées en biais définissent des aires géométriques limitées, voire des pièces.
L’espace central de la mosaïque était vraisemblablement de dominante blanche, en
tesselles de petite taille, et délimité par des cadres successifs de tesselles noires ou
blanches. Les différents fragments de la cour peuvent aussi bien appartenir à deux
pièces différentes (une à l’ouest, l’autre à l’est), ou à deux tapis
juxtaposés. Dans l’hypothèse où les cadres ne constituent pas des limites de
pièces, ils peuvent jouer le rôle de bandes de raccord. S’il existait un décor
central, il ne peut être restitué par manque d’éléments. Quant à sa datation,
par comparaison avec les exemples précités, elle doit s’intégrer entre le
Ier et le IIe siècle ; les vestiges mobiliers et l’observation stratigraphique nous
permettant de limiter cette fourchette chronologique à la seconde moitié du Ier siècle. Ainsi, pour la même période nous
disposons d’indices sûrs, bien que lacunaires, pour envisager une occupation de la
parcelle par deux éléments d’habitation faisant peut-être partie d’un même
ensemble, l’un donnant sur une rue, l’autre au centre ou en fond de parcelle.
Dans cette hypothèse, le traitement apporté à chacun des deux ensembles mosaïqués
témoigne d’une plus grande qualité dans la confection de celui jouxtant la rue Mage
; cela peut indiquer une prédominance dans l’importance attribuée à la structure
ouvrant l’accès à la parcelle, différenciation vraisemblablement en rapport avec
une dévolution différenciée de ces deux bâtiments.
1. Cette fouille de sauvetage urgent entrait dans le cadre d’une intervention
avant travaux ; elle a eu lieu en deux phases, en août et septembre 1994 et en février
et mars 1995. La congrégation des Sœurs de la Charité-Présentation de la Sainte
Vierge en était le maître d’ouvrage. La gestion de l’intervention
archéologique a été confiée à l’A.F.A.N. et le suivi de l’opération
assuré par le Service Régional de l’Archéologie de la D.R.A.C. de Midi-Pyrénées.
2. J.-Ch. Arramond, S. Bach, Q. Cazes : « Vestiges d’une tannerie des XVe-XVIe siècle à Toulouse » dans Archéologie
du Midi Médiéval, à paraître en 1996.
3. Plaquettes dont les dimensions varient de 10 x 20 cm à 3 x 5 cm. Les tesselles noires
mesurent 1 x 2 cm et les blanches 1 cm2.
4. Par exemple à Saint-Bertrand-de-Comminges (C. Balmelle, Recueil général des
mosaïques de la Gaule, Province d’Aquitaine, Xe supplément à Gallia, t. IV, 1, Paris, C.N.R.S., 1980, p. 46-49),
Saint-Paul-Trois-Chateaux (H. Lavagne, Recueil général des mosaïques de la Gaule,
Province de Narbonnaise, Xe
supplément à Gallia, t. III, 1, Paris, C.N.R.S., 1979, p. 95), Apt (H. Lavagne, ibidem,
p. 150), Saint-Romain-en-Gal (J. Lancha, Recueil général des mosaïques de la Gaule,
Province de Narbonnaise, Xe
supplément à Gallia, t. III, 2, Paris, C.N.R.S., 1981, p. 253).
5. Par exemple à Carpentras (H. Lavagne, op. cit., p. 87),
Saint-Paul-Trois-Chateaux (ibidem, p. 96-98), Vienne (J. Lancha, op. cit.,
p. 29)., Saint-Romain-en-Gal (ibidem, p. 225), Saint-Bertrand-de-Comminges (C.
Balmelle, op. cit., p. 34-57), Périgueux (« Informations archéologiques », Gallia,
t. 37, 2, Paris, C.N.R.S., 1979, p. 498-502), Fréjus (« Informations archéologiques »,
Gallia, vol. 1-2, Paris. C.N.R.S., 1990, p. 206-214), Attricourt (« Informations
archéologiques », Gallia, t. 44, 2, Paris, C.N.R.S., 1986, p. 254-256), Limoges
(J.-P. Loustaud, « Les Thermes de la place des Jacobins à Limoges » dans Aquitania,
t. VI, Bordeaux, 1988, p. 81-124). »
M.S.A.M.F., T. LVI, page 290
SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 1995
Présents : MM. Pradalier, Président, Ahlsell de Toulza, Trésorier, Latour,
Bibliothécaire-archiviste, Cazes, Secrétaire Général, Scellès, Secrétaire-adjoint ;
Mmes Blanc-Rouquette, Labrousse, Merlet-Bagnéris, Pradalier-Schlumberger,
Watin-Grandchamp, MM. Bertrand, le général Delpoux, Hermet, Julien, Mange, Nayrolles, le
Père Montagnes, Péaud-Lenoël, Peyrusse, l’abbé Rocacher, Tollon.
Invitée : Mme Latour.
Le Président accueille la Compagnie dans le réfectoire des
Jacobins où est installée l’exposition
Le regard de Rome : portraits romains de Tarragone, Mérida et Toulouse, à
laquelle est consacrée la séance du jour.
Le Président rappelle que l’exposition a été présentée à
Tarragone, au printemps, puis à Mérida, cet été, avant de l’être à Toulouse, et
qu’elle a été demandée par Rome où elle sera accueillie dès février prochain.
Sans plus attendre, il donne la parole à Daniel Cazes, membre de notre Société et
conservateur du Musée Saint-Raymond, qui a été l’un des maîtres d’œuvre
de cette exposition avec les conservateurs des Musées de Tarragone et Mérida.
Daniel Cazes évoque en premier lieu les origines du projet, trois
ans plus tôt, alors qu’il s’agissait très modestement d’échanger des
œuvres à l’occasion d’expositions temporaires, afin de faire bénéficier
chaque musée des compléments que pouvaient lui apporter les deux autres collections de
sculpture romaine. Mais il est vite apparu que les trois collections rendaient possible un
projet commun plus ambitieux : une exposition consacrée au portrait romain.
Si les spécialistes disposaient d’une bibliographie nombreuse,
l’exposition pouvait faire découvrir à un public plus large un aspect majeur de la
sculpture romaine qui est le plus souvent un peu méprisée, et inviter nos contemporains
de la fin du XXe siècle à un jeu
de miroir en portant un regard nouveau sur ce qu’a été Le regard de Rome.
À cette fin, on a fait le choix d’une exposition didactique,
servie par une mise en scène qui a le mérite de n’être jamais gratuite et qui peut
jouer à évoquer la pompe impériale ou le faste des villes romaines sans pour cela se
substituer aux œuvres.
Le propos est articulé en sept chapitres principaux matérialisés par les sections de l’exposition.
1. Le pouvoir des images. Le mythe brisé
Le visiteur est accueilli par un splendide portrait d’Auguste
arborant la couronne civique qui lui a été attribuée par le Sénat en 27 av. J.-C. Avec
six autres visages, il exprime dans le luxe et la pérennité du marbre une iconographie
politique où le pouvoir des images sert la stabilité d’un système social. Reflets
d’une culture homogène du bien-être, les portraits impériaux et ceux qui s’en
inspirèrent ont contribué à la création d’un véritable mythe de l’Empereur.
Le mythe se brise avec les crises qui secouent l’Empire et le
développement du christianisme s’accompagne de la destruction des images divines et
des effigies impériales, illustrée ici par une reproduction d’un graffiti de la
catacombe de la Porta Pinciana à Rome. Statues décapitées, visages mutilés…
rappellent les conditions de leur disparition et de leur redécouverte.
2. L’Antiquité admirée et retrouvée
Modèle politique et juridique jamais vraiment oublié, objet de l’admiration des humanistes, académiciens et antiquaires, retrouvée par les historiens et les archéologues modernes, l’Antiquité romaine n’a cessé de fasciner. Ses portraits ont été l’un des vecteurs essentiels de ce goût. Ils furent soumis, de la Renaissance à nos jours, à des études toujours plus précises et leur conservation généra les splendides collections et galeries de nos musées.
3. Matériaux et techniques. Formes et intentions
Après avoir évoqué les origines du phénomène du portrait
romain, encore très discutées, des œuvres variées illustrent les techniques
utilisées et les codes de la représentation.
Tous les matériaux ont servi pour la réalisation et la diffusion des
portraits : métal des monnaies, des statues et des œuvres d’art de petite
dimension, pierre dure des intailles, terre cuite, calcaire et marbre divers parfois
associés pour jouer de leur polychromie…
La plate-tombe de l’évêque de Tarragone Optimus, de la seconde
moitié du IVe siècle ou du début
du Ve, permet d’y ajouter la
mosaïque en même temps qu’elle introduit aux mutations que le portrait connaîtra
dans l’Empire devenu chrétien.
À côté des techniques, sont présentées les diverses formes que
prit le portrait romain : l’aspect fonctionnel de l’œuvre, le costume, les
attributs, les gestes sont autant d’indices du rang social et des intentions des
individus représentés.
4. L’image de l’empereur et sa diffusion
Les portraits officiels de l’empereur dépendaient d’un prototype, créé généralement à Rome, le centre du pouvoir. À partir de celui-ci, les sculpteurs produisaient des répliques dont la codification iconographique était rigoureusement imposée mais dont
M.S.A.M.F., T. LVI, page 291

L'EXPOSITION LE REGARD
DE ROME, organisée par les musées de Mérida, Tarragone et
Toulouse,
et présentée dans le réfectoire des Jacobins de Toulouse à l'automne 1995.
Cliché Musée Saint-Raymond, J. Rougé.
la facture pouvait varier. Plusieurs portraits de Marc Aurèle et de Lucius Verus
conservés à Toulouse, Tarragone et Mérida témoignent de cette pratique liée à une
large et rapide diffusion de l’image impériale dans les provinces.
Cinq portraits de Septime Sévère montrent trois types iconographiques
distincts. Ils concordent avec des moments différents du règne et de la pensée
politique ou religieuse de l’empereur.
5. Théâtre, forum et scénographie du pouvoir
Les théâtres romains, grands lieux de rassemblement des
populations urbaines, étaient un cadre idéal pour les statues figurant les empereurs et
leurs proches, comme le montrent les œuvres découvertes dans ceux de Tarragone et de
Mérida. À Tarragone, un autel atteste même un culte adressé à la puissance divine de
l’empereur.
Les forums municipaux de Béziers, avec un exceptionnel ensemble de
portraits julio-claudiens, de Tarragone et de Mérida apparaissent naturellement comme les
espaces publics les plus appropriés à la mise en valeur des portraits impériaux et au
développement de programmes statuaires liés à l’exercice du pouvoir.
6. Mimétisme et individualité. Usages privés, regards publics
L’universalité du portrait romain explique la diversité des individus dont nous connaissons la physionomie. Tous n’étaient pas des empereurs ou des personnages publics aux effigies multiples. Beaucoup, désignés par les inscriptions accompagnant leur image, peuvent être situés dans la sphère « privée » de la société romaine et c’est probablement le cas de bien d’autres figurations, notamment funéraires. Mais le mimétisme ambiant, phénomène typiquement social, ne permet pas toujours de différencier sans ambiguïté l’effigie privée de l’officielle. Ainsi tel jeune homme dépend-il d’un portrait de Trajan et certaines têtes féminines font-elles hésiter entre une impératrice et une digne matrone l’imitant. Enfin, sous l’Empire se maintiennent des traditions iconographiques républicaines ou surgissent des réminiscences et des particularismes autochtones.
M.S.A.M.F., T. LVI, page 292
7. La permanence des images
La production des portraits diminua au cours des IIIe et IVe siècles, mais les effigies impériales continuèrent à jouer leur rôle dans la transmission de l’idéologie officielle. Cette permanence est marquée, à la fin de l’exposition, par le rare groupe, récemment identifié par Jean-Charles Balty qui propose de le dater de l’année 293, des quatre têtes de l’empereur Maximien Hercule, de sa femme Eutropia, de son fils Maxence, futur empereur, et de son épouse Maximilla.
Le Président remercie Daniel Cazes de cette complète et
passionnante présentation d’une exposition trop riche pour être épuisée en deux
heures. Il relève que le titre retenu était prémonitoire puisque c’est finalement
à Rome que s’achèvera le cycle. Remarquant l’exceptionnelle qualité des
portraits provenant de la villa de Chiragan, il s’interroge sur le rôle
qu’a joué notre Société dans leur découverte. Après avoir rappelé qu’il se
propose de développer cet aspect au cours d’une communication prochaine, Daniel
Cazes indique que la Société Archéologique du Midi de la France, fondée en 1831, a
surtout agi comme intermédiaire lorsque les fouilles ont repris à partir de 1842, mais
que l’essentiel des sculptures trouvées sur le site l’avait été par Du Mège
dans les années 1826 à 1830.
En réponse à une question de Jean Nayrolles, Daniel Cazes précise
que Du Mège avait en effet prévu la restauration des bustes antiques à laquelle
contribuèrent peu ou prou tous les sculpteurs de Toulouse. Il ajoute que les portraits de
Mérida n’ont pas été restaurés parce que découverts au moment où l’on
s’interrogeait sur l’opportunité de telles restaurations.
Guy Ahlsell de Toulza voudrait savoir si le groupe de Béziers ne
comportait que des bustes ou si, au contraire, les portraits faisaient partie de
sculptures en pied. Daniel Cazes répond qu’il s’agissait très certainement de
statues, mais que les corps ont disparu, la « fouille » de Béziers n’ayant livré
que des fragments de marbre divers dont des fragments de doigts.
Pascal Julien s’étonne de l’absence d’œuvres
provenant de Toulouse et demande s’il n’y a jamais été retrouvé aucune statue
impériale. Daniel Cazes rappelle que l’on possède un fragment de statue cuirassée,
d’ailleurs d’une extraordinaire qualité, qui provient de Toulouse mais rien de
plus hormis des dizaines de petits fragments qui témoignent d’une statuaire qui a
bien sûr existé mais dont on ne sait rien.
À propos de la mosaïque funéraire d’Optimus, Daniel Cazes
attire l’attention de la Compagnie sur un détail du vêtement : la manche est en
effet ornée d’une double bande bleue, comme dans les représentations des évêques
Ambroise et Maternus, sur une mosaïque murale de la fin du Ve siècle qui se trouve dans la chapelle San Vittore in Ciel d’oro de la
basilique Saint-Ambroise de Milan. Il semble donc bien que cette double bande bleue
caractérise le costume d’un évêque, et que la mosaïque d’Optimus, de la fin
du IVe ou du début du Ve siècle, en soit la plus ancienne
représentation connue.
SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1995
Présents : MM. Pradalier, Président, Ahlsell de Toulza, Trésorier, Latour,
Bibliothécaire-archiviste, Cazes, Secrétaire Général, Scellès, Secrétaire-adjoint ;
Mmes Blanc-Rouquette, Bourdieu, Cazes, Labrousse, Napoléone, Noé-Dufour, Suau,
Watin-Grandchamp, MM. Bernet, Bertrand, Cranga, Fabre, Ginesty, Hermet, Julien, Mange,
Nayrolles, Peyrusse, l’abbé Rocacher, Tollon.
Excusé : M. Péaud-Lenoël.
Le Président donne la parole au Secrétaire-adjoint pour la lecture
des procès-verbaux des séances des 7 et 21 novembre derniers.
Le Président indique qu’il a écrit au Conservateur régional de
l’archéologie, M. Michel Vidal, pour lui donner l’accord de notre Société au
classement au titre des Monuments historiques de l’ensemble des parcelles qui lui
appartiennent à Martres-Tolosane.
Le Président rend compte de deux réunions qui se sont tenues dans le
cadre de l’Union des Académies et Sociétés Savantes de l’Hôtel
d’Assézat et de Clémence Isaure, puis présente la correspondance reçue.
Le Maire de Toulouse nous a adressé un exemplaire du projet élaboré
par le S.M.E.A.T., ce document devant permettre de recueillir observations et remarques.
Le Président rappelle que notre Directeur, M. Coppolani, a représenté la Société à
certaines séances du S.M.E.A.T.
Les rapporteurs entendus, M. Éric Morvillez et M. Jean-Marc Luce sont
élus membres correspondants.
La parole est ensuite à Catherine Bourdieu pour une communication sur Les œuvres religieuses du sculpteur Pierre Affre (v. 1590-1669) dans la région toulousaine :
« Né à Béziers et arrivé à Toulouse avant 1617, le sculpteur Pierre Affre a fondé son atelier dans la capitale languedocienne dès le milieu des années 1620. À l’exemple de bien des artistes de son temps, sa carrière s’est orientée en partie, mais tout
M.S.A.M.F., T. LVI, page 293
naturellement vers l’art religieux. Commandes prestigieuses, comme le décor de la chapelle de Garaison (1635-1666) et le grand retable de l’église Saint-Sernin (1645), ou bien ouvrages plus modestes, comme les bustes reliquaires du Fauga (1653) et de Rabastens (1655), Affre a réalisé ces œuvres pour des clients issus de plusieurs diocèses méridionaux : d’Arreau en Comminges à Bordeaux, Limoges, Brive ou Saint-Papoul. Malheureusement, en raison de leur nombre très réduit, ses œuvres conservées (six retables sur dix-sept, plus deux dessins) ne peuvent refléter qu’une image incomplète de son talent. Les jeunes sculpteurs formés dans son atelier ont prolongé avec difficulté son style aux formes sobres mais épanouies et majestueuses. Son fils François, le plus doué, a disparu prématurément et Simon, un autre de ses fils, ne possédait qu’un talent limité. Antoine Guépin, son gendre, montre un art très influencé par celui de Pierre Affre, sans atteindre bien souvent à la même maîtrise. »
Le Président remercie Catherine Bourdieu en regrettant que la
mauvaise qualité des diapositives n’ait pas permis à l’auditoire de se faire
une idée précise du style du sculpteur et de la qualité des œuvres.
Maurice Scellès s’étonne que l’on ait fait appel à un
sculpteur qui lui paraît bien médiocre, pour des chantiers dont il se demande s’il
s’agit de chantiers de second rang. N’y avait-il pas d’autres sculpteurs à
Toulouse ? Catherine Bourdieu conteste le jugement porté et confirme qu’il
s’agit au contraire de commandes de premier plan.
Pascal Julien atténue le jugement trop sévère de Maurice Scellès,
en remarquant cependant que si Pierre Affre n’est pas un mauvais sculpteur, ce
n’est pas non plus un grand artiste. Les choses changent en fait au milieu du
siècle. En 1653, Pierre Affre donne le dessin d’un jubé pour Saint-Sernin, jubé
dont l’exécution est reportée en raison de divers problèmes financiers. Mais en
1662, c’est le moment où l’on décide d’ériger un grand retable à la
cathédrale Saint-Étienne, qui est commandé à Gervais Drouet. Celui-ci introduit à
Toulouse le Baroque romain qui supplante le classicisme attardé qui prévalait jusque
là.
Bruno Tollon reproche à cette analyse d’être trop imprégnée
d’une vision linéaire de l’histoire. Pour Louis Peyrusse, les catégories du
Baroque déforment notre perception de l’œuvre de Pierre Affre. Celui-ci
appartient au premier art de la Contre-réforme et ses sculptures se caractérisent
justement par une certaine forme de retenue et la recherche de l’intériorité.
SÉANCE DU 9 JANVIER 1996
Présents : MM. Pradalier, Président, Coppolani, Directeur, Ahlsell de Toulza,
Trésorier, Latour, Bibliothécaire-archiviste, Cazes, Secrétaire Général, Scellès,
Secrétaire-adjoint ; Mmes Blanc-Rouquette, Cazes, Napoléone, Noé-Dufour,
Pradalier-Schlumberger, Watin-Grandchamp, MM. Bernet, Bertrand, Blaquière, Catalo,
Cranga, le général Delpoux, Gilles, Gillis, Ginesty, Hermet, Julien, Lassure, Luce,
Mange, Manuel, le Père Montagnes, Nayrolles, Péaud-Lenoël, Peyrusse, l’abbé
Rocacher, Tollon.
Excusés : Mmes Bourdieu, Fraïsse, M. Gérard.
Le Président rend compte de la correspondance manuscrite. Nous
avons en particulier reçu une lettre de M. Manuel, d’ailleurs présent
aujourd’hui parmi nous, qui remercie notre Société de son élection comme membre
correspondant, qui honore ainsi la Société des Amis du Vieux Cordes dont il a été
longtemps le Président. Relevant la modestie dont fait preuve M. Manuel, Henri Pradalier
lui affirme que son élection tient d’abord à ses mérites personnels.
Le Secrétaire Général de l’association FERMAT, M. Ferron, nous
a fait parvenir une vingtaine d’exemplaires à distribuer du n° 1 de la Lettre
des Amis de l’Hôtel d’Assezat, qui est aussi un appel à l’adhésion.
Le Président fait circuler deux clichés en couleur d’un coffret-reliquaire émaillé que lui a adressés
Neil Stratford. Il s’agit d’une œuvre de Limoges, qui peut être datée des
environs de 1200 et qui pourrait provenir selon Marie-Madeleine Gauthier d’une
église auvergnate. Ce coffret nous intéresse plus particulièrement parce que la scène
figurée représente le martyre de saint Sernin et parce qu’il a récemment été mis
en vente à Londres par Sotheby’s. La Ville de Toulouse s’est décidée à se
porter acquéreur, mais aurait prévu une somme insuffisante, d’ailleurs de peu
inférieure au prix de vente. Toulouse vient donc de manquer une œuvre
exceptionnelle, dont l’acquisition aurait pu se faire dans un contexte tout aussi
exceptionnel puisque nous allons commémorer le 9e centenaire de la
consécration de Saint-Sernin.
On ne peut que déplorer que la Ville n’ait pas acheté ce
coffret, alors même que les crédits d’acquisition mis à la disposition des musées
de Midi-Pyrénées par l’État ne sont jamais entièrement consommés. Le Directeur
régional des Affaires culturelles a lui-même protesté solennellement au cours
d’une récente réunion des conservateurs parce qu’il était obligé de
retourner d’importants crédits qui n’avaient pas été utilisés. À la
mi-septembre 1995, seuls trois conservateurs avaient présenté des dossiers d’achat
d’œuvres, au demeurant relativement modestes. Il faut savoir que le financement
par l’État peut aller jusqu’à 50 %, part à laquelle peuvent encore
s’ajouter jusqu’à 20 % alloués par les départements ou la Région. Il y a de
quoi s’interroger sur les politiques d’acquisition de la Ville de Toulouse et
des autres collectivités territoriales de la région.
M.S.A.M.F., T. LVI, page 294
|
COFFRET-RELIQUAIRE ÉMAILLÉ, |
COFFRET-RELIQUAIRE ÉMAILLÉ, |
M.S.A.M.F., T. LVI, page 295
Henry Ginesty fait remarquer que la part restant à la charge de la Ville dont dépend le musée peut être supérieure à ses possibilités quelle que soit l’importance des autres financements. Pascal Bertrand rappelle que le montage financier des dossiers est en fait assez complexe, et que les acquisitions sont soumises à l’approbation de ce que l’on appelle le « petit conseil ». Guy Ahlsell de Toulza affirme que la procédure peut être très accélérée si cela est nécessaire, et que tout peut être réglé en 24 heures.
Le Président donne alors la parole au Secrétaire-adjoint pour la
lecture des procès-verbaux des séances des 5 et 19 décembre derniers. Le Président
ajoute que Catherine Bourdieu aurait vivement souhaité poursuivre la discussion sur
Pierre Affre, mais qu’il lui était absolument impossible d’être parmi nous
aujourd’hui.
On entend ensuite les rapports sur les candidatures de M. Marc
Salvan-Guillotin et Mme Christine Aribaud, qui sont élus membres correspondants de notre
Société.
La parole est à Jean Catalo pour la communication du jour : Les fouilles de l’Hôtel d’Assézat, publiée dans ce volume (t. LVI, 1996) de nos Mémoires.
Le Président remercie Jean Catalo d’avoir bien voulu répondre
à sa demande en étant bref, et le félicite d’avoir cependant su nous faire une
présentation claire de ces fouilles.
Le général Delpoux demande des précisions sur la profondeur des
découvertes par rapport au sol actuel. Jean Catalo indique que les niveaux les plus
anciens ont été trouvés à 5 m de profondeur, ces cinq mètres comprenant environ 3 m
de remblais sans doute dus aux incendies. Le niveau des graviers de Garonne est à peu
près le même que celui qui a été repéré de l’autre côté de la rue
Peyrolières. À une question d’Henri Pradalier, il répond que la nappe phréatique
doit se situer à environ 5 m du sol actuel, mais qu’il s’agit d’une simple
estimation car la construction de la paroi moulée qui a précédé la fouille et le
pompage constant en ont évidemment modifié le niveau.
Quitterie Cazes dit son admiration devant les résultats de cette
fouille, et en particulier devant la découverte exceptionnelle que constituent les
vestiges de la grande domus urbaine et du bassin qui l’agrémentait ; elle
rappelle que c’est la première fois que sont mis au jour dans Toulouse les vestiges
d’une maison romaine.
Louis Peyrusse demande si l’on connaît d’autres exemples,
dans d’autres villes, de demeures urbaines de cette importance situées, comme à
Toulouse, à proximité immédiate de grands édifices publics comme le théâtre ou le
temple du Capitole. Jean Catalo souligne le fait que les fouilles en centre ville sont
finalement assez peu nombreuses, et qu’il est rare qu’elles permettent de saisir
des ensembles de ce type ; on a eu ici la chance de pouvoir déterminer les dimensions du
bassin, ce qui nous donne une meilleure idée de l’importance de la demeure.
Le Président voudrait avoir des précisions sur les datations
proposées. Jean Catalo indique que les principaux indices de datation sont donnés par
les céramiques arétines et sigillées gauloises, produites à Montans et la
Graufesenque. La première occupation peut être située entre - 10 av. J.-C. et 10 après
J.-C. Quant à la domus, elle se place entre 0/30 après J.-C. et 40/80.
En réponse à une question du général Delpoux, Jean Catalo
rappelle que la cour principale de l’Hôtel n’a pas été fouillée, et que le
suivi des travaux de tranchées qui y ont été réalisés a seulement permis de confirmer
la datation… de la construction de l’Hôtel d’Assézat. Par ailleurs, les
deux niveaux de caves de l’Hôtel, dont la profondeur est supérieure à 5 m, ont
certainement fait disparaître des niveaux d’occupation antérieure.
Maurice Scellès s’interroge sur le fait qu’un regroupement
parcellaire ait été réalisé au XIVe siècle sans projet de reconstruction. Quel est l’intérêt d’une
telle opération, et ne peut-on faire l’hypothèse d’un projet abandonné ? Jean
Catalo ne le croit pas, pour la raison que l’on a plusieurs exemples de regroupements
parcellaires dans ce même îlot, ce qui laisse entendre que l’on est en présence de
pratiques liées à des spéculations foncières sans projet architectural.
Bruno Tollon souligne la richesse des informations que livre ce
travail, ce qui met une fois de plus en évidence tout l’intérêt de travailler en
équipe. Il relève que le fait que l’impôt ait été calculé en fonction de la
largeur sur la rue doit être mis en relation avec les dispositions d’hôtels dites
« en poêle à frire », c’est-à-dire se développant en fond de parcelle à partir
d’un simple accès à la rue. Il est certain que seule la prise en compte de sa
complexité peut permettre d’aborder l’étude de milieu urbain.
Guy Ahlsell de Toulza demande quelles sont les traces effectivement
repérables de l’incendie de 1463. Jean Catalo précise que bien sûr seules les
fondations des bâtiments ont pu être observées, et que l’on ne retrouve pas les
traces de l’incendie lui-même. Ce sont en fait les remblais d’incendie,
comportant des matériaux qui ont subi l’action du feu, qui ont été produits par
les démolitions des bâtiments endommagés.
Au titre des questions diverses, Maurice Scellès annonce que deux nouveaux échanges de publications viennent d’être mis en place, l’un avec Udine en Italie, l’autre avec l’Institut archéologique de Londres.
Louis Peyrusse attire une nouvelle fois l’attention de la Compagnie sur les travaux de restauration réalisés à Saint-Sernin :
« Je souhaiterais attirer l’attention sur l’étonnante
restauration de la Porte Miègeville à Saint-Sernin, sans vouloir relancer une
polémique, puisque par deux fois la Commission Supérieure des Monuments Historiques, en
1979 et 1990, a décidé de dérestaurer l’œuvre de Viollet-le-Duc.
Avant l’intervention de Viollet-le-Duc, la porte Miègeville
était couronnée d’un édicule très simple exécuté en 1752 : un attique mouluré
creusé d’un tableau. En témoignent la lithographie d’après Fragonard fils
publiée dans les Voyages Pittoresques du baron Taylor (1834) et les calotypes de
la collection Le Pourhiet (v. 1855).
M.S.A.M.F., T. LVI, page 296
Viollet-le-Duc l’avait remplacé par un fronton polygonal dont
les rampants étaient soutenus par trois colonnes saillantes ; le tympan était décoré
de deux oculi aveugles (un damier bicolore brique et marbre). Ce fronton était à
l’origine amorti par des sculptures données par l’architecte : « ces bêtes
d’amortissement » rappelant les chimères de Pierrefonds, avaient depuis longtemps
disparu.
Ce tympan, sans le décor sculpté des amortissements, était conservé
dans les dessins de dérestauration de M. Yves Boiret, projet accepté par la Commission
Supérieure des Monuments Historiques en 1990. Pourquoi ce geste de conservation ?
Difficile à dire. Sans doute par l’application homéopathique de la Charte de Venise
précisant que les apports valables de toutes les époques à l’édification
d’un monument doivent être respectés. Sans doute le dernier geste pour saluer
Viollet-le-Duc : une trace incomplète pour le siècle de l’Histoire.
Il faut croire que ces élévations plusieurs fois publiées,
présentées dans des expositions, arrêtées par la Commission Supérieure des Monuments
Historiques, étaient susceptibles de révision selon l’humeur de l’architecte
puisqu’il a décidé de gommer tout souvenir de Viollet-le-Duc pour restituer «
l’état antérieur ».
On pourrait sourire si cette démarche ne contenait en soi
d’inquiétantes perspectives. Car pour être logique avec lui-même, M. Boiret
devrait rétablir les consoles d’amortissement installées en 1752 au sommet des
contreforts ; il devrait démolir l’enfeu des comtes de Toulouse dont le décor
moissagais refait au XIXe siècle ne peut que lui être
insupportable, et rétablir la chapelle avec façade des XVIIe
et XVIIIe siècles. Dans l’élan, pourquoi ne pas
démolir le complément apporté à la façade occidentale par Hulot entre 1920 et 1929 ?
On sourirait si, sur ce point comme sur d’autres, la logique parfaite dont se
réclame M. Yves Boiret n’apparaissait comme fausse et incapable de parvenir à un
retour à l’état antérieur attesté. On sourirait si la désinvolture avec
laquelle on a agi sur Saint-Sernin ne faisait craindre le pire pour la restauration à
venir de l’abside principale dont tout laisse croire qu’elle sera encore une
fantaisie de l’Architecte en Chef. On sourirait si la présentation de la dernière
« restauration » reconstruite n’était pas des plus étranges : alors que les murs
supérieurs de Saint-Sernin sont reconstruits en parpaings dissimulés par des briques de
parement unifiées par un traitement à l’acide qui leur donne un aspect rose bonbon,
le nouveau couronnement de la porte Miègeville est traité avec un ciment gris qui jure
dans la confiserie ambiante.
On espère qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle façon de
signaler à l’attention les restitutions de M. Boiret, mais d’un état
d’attente jusqu’à ce que soient nettoyées les sculptures de la porte
Miègeville. Car c’est sans doute la raison pour laquelle les reliefs sculptés de
saint Jacques et de saint Pierre sont maintenus sous une « protection » de chantier
élémentaire ?
On s’interroge et on s’inquiète. Avec une verve féroce, en
1990, M. Boiret avait dénoncé dans les erreurs de la restauration réalisée sous la
direction de Viollet-le-Duc à la fin du Second Empire des erreurs de vieillesse du grand
architecte, trop sûr de lui et de son système. L’Histoire se répète-t-elle ? On
constate avec tristesse que sur un chantier essentiel et qui devrait être exemplaire, les
mauvaises habitudes des chantiers des Monuments Historiques continuent de fonctionner et
que ce service est incapable de faire respecter ses propres décisions par des employés
qui, en lui imposant le poids de leur lobby, se permettent de défigurer le patrimoine
avec l’argent public. »
Louis Latour dit qu’il avait été également surpris par les
travaux en cours, et que pour en savoir un peu plus il avait essayé de lire le panneau
explicatif installé par le Service des Monuments historiques à proximité. Il
s’était trouvé obligé de conclure qu’aucune décision n’avait encore
été prise pour cette partie de l’édifice au moment de sa rédaction.
Pour le Président, il y a de quoi s’interroger en constatant que
le projet approuvé par la Commission supérieure des Monuments historiques ne correspond
finalement pas entièrement aux travaux exécutés.
On rappelle par ailleurs que les deux reliefs du portail Miègeville
qui représentent saint Pierre et saint Jacques sont restés masqués par des
contre-plaqués après la dépose des échafaudages au printemps 1995. Tous ceux qui
depuis ont visité Toulouse et la basilique ont dû être ravis d’apprendre, par un
petit panneau fiché hâtivement dans la pelouse, que la présence de ces plaques était
nécessitée par des analyses en cours. On sait bien que ces contre-plaqués ont en fait
été installés pour protéger les sculptures pendant les travaux… On attend
maintenant avec impatience les passionnants résultats des études « scientifiques »
annoncées.
La Compagnie est informée de la disparition récente de statuettes
du portail de l’église de la Dalbade. Lorsque la photographie présentée a été
prise, une seule niche était vide, mais ce sont maintenant huit statuettes qui ont
disparues et qui ont peut-être été volées en profitant des échafaudages installés
par les Monuments historiques sans aucune protection.
Pascal Bertrand ajoute qu’à l’Hôtel de Malte voisin, il
sera bientôt nécessaire de doubler le filet installé sous la corniche en raison des
chutes de pierres. Il constate également que des fenêtres sont ouvertes, des vitres
cassées et se demande quel était alors l’intérêt de fermer l’entrée par un
grand rideau de fer. Le général Delpoux ajoute qu’un témoin lui a affirmé que
deux cheminées en marbre avaient été volées récemment à l’Hôtel de Malte.
Dominique Watin-Grandchamp présente une communication sur le pavillon « Louis XVI », rue Henri-Glady à Cugnaux :
« L’ancien domaine de Lacans dit « pavillon Louis XVI » sur
la commune de Cugnaux est situé dans l’ancienne ceinture viticole de Toulouse, le
long d’une route où les parlementaires de la seconde moitié du XVIIIe siècle achètent des propriétés et
font bâtir. L’édifice qui nous intéresse est lié à son parc qui se développe
encore à l’Ouest. Il représente un plan en U avec 2 ailes de dépendances en retour
sur cour à l’Est.
L’aile nord abrite des pièces à fonction domestique, rejetées
du pavillon central ainsi que des remises et écuries. L’aile sud est occupée par un
chais.
M.S.A.M.F., T. LVI, page 297
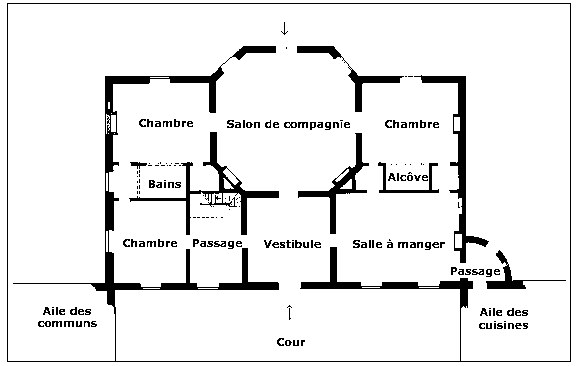
CUGNEAUX (HAUTE-GARONNE),
DOMAINE DE LACANS, plan du rez-de-chaussée.
Relevé D. Bertrand-Marchenoir.
Dans le parc, le tracé conservé des allées de buis répond
parfaitement aux percements de l’avant-corps du pavillon central qui abrite un
prestigieux salon de compagnie. Sur cour, la façade est traitée sans apparat avec 5
travées simples, celle du centre étant marquée par deux pilastres ; la façade sur
jardin a fait l’objet d’un soin particulier avec les 5 travées marquées par
des pilastres à faux bossage de brique. Le salon de compagnie qui répond à cette
élévation est de plan octogonal et 3 pans de l’octogone occupent les 3 travées
centrales débordantes ornées de bas-reliefs de terre cuite. Une balustrade pleine marque
un faux attique où les pilastres sont amortis par des pots de terre cuite.
Cette façade évoque des modèles célèbres inspirés de Jacques Ange
Gabriel et en particulier le parti et les dispositions du pavillon de chasse du Butard
entre Versailles et Marly. Dans le milieu toulousain, des comparaisons sont possibles avec
Reynerie et c’est sans doute un bon exemple des contacts des artistes locaux avec le
milieu parisien.
Le salon de compagnie, d’environ 6 x 6 m, est le cœur de
l’ensemble et sa décoration, stucs et toiles peintes, est prestigieuse. C’est
aux qualités de chercheur de M. Burroni que nous devons sa découverte. En effet, pour la
restauration des stucs de l’hôtel Dubarry à Toulouse, il avait recherché un
édifice cité dans la thèse de Mme Faucher-Magnan (un procès entre Dubarry et le
peintre F.-C. Derome signalait que Julia, auteur des stucs de l’hôtel Dubarry, avait
également travaillé dans ce pavillon de Cugnaux).
L’édifice « retrouvé » abritait bien des modèles de Julia
mis en œuvre à l’hôtel Dubarry après 1777 et à Reynerie après 1781. Ici,
les panneaux de Julia célèbrent les arts avec des sphinx qui annoncent l’Empire.
Outre ses chantiers toulousains, Julia travaille à l’opéra de
Versailles avec Pajou de 1768 à 1770. Ils se côtoient également à l’Académie des
Beaux-Arts de Toulouse où Pajou est reçu en 1777, après avoir exposé aux salons de
1767 et 1770. Ils travailleront tous deux dans la classe de Lucas et l’iconographie
du décor de Cugnaux peut se lire comme un hommage à l’école toulousaine et à ses
maîtres, du moins si on considère un Apollon en médaillon répété plusieurs fois, qui
est la copie d’un marbre de la galerie des Offices de Florence faite par Lucas et
exposée au salon de 1775 avec un grand succès.
Les panneaux de toiles peintes qui habillaient les murs du salon ont
été retrouvés après bien des péripéties et restaurés à l’instigation de Mme
Sire, inspecteur des Monuments Historiques. Ces panneaux sont des éléments de
décoration intérieure rares dans nos contrées, dans la manière de Rançon ou de Mique
pour le boudoir de Marie-Antoinette. Ils puisent leur inspiration dans la Renaissance
italienne avec des petits panneaux en grisaille, des arabesques, des vases aux
camées… Des rinceaux habités d’oiseaux mettent en valeur des scènes
champêtres ou des marines.
Le problème de l’attribution précise de ce décor reste posé :
il y a peu de peintres de marine dans le milieu local, mais deux peintres familiers de
Dubarry et très influencés par les marines de Vernet ont pu le réaliser. Le premier est
François Valentin Gazart, qui quitte Toulouse pour Versailles en 1786, mais en gardant
des contacts avec l’Académie de Toulouse et en particulier avec le sculpteur Lucas.
Le second est Pierre Joseph Wallaert dont la manière semble bien correspondre à ce
décor : né à Lille en 1755, il a un atelier à Toulouse en 1786, il est membre de
l’Académie et élu artiste associé en 1787. On lui attribue des paysages peints à
la détrempe dans le salon du comte Dubarry au château de Lévignac. Il fréquente
également Lucas.
M.S.A.M.F., T. LVI, page 298
| 2e partie Séances du 23 janvier 1996 au 30 mars 1996 |
3e partie Séances du 2 avril 1996 au 18 juin 1996 |